La marchandisation d’une dépression redéfinie à des fins commerciales. Silence des firmes sur les risques de dépendance, d’effets secondaires graves, de syndrome de sevrage… Texte de Janet Currie (I)
Merci au médecin qui m’a signalé cet excellent texte! Il vaut la peine d’être lu en entier, et pas seulement par les femmes. Si elles sont une cible privilégiée pour des raisons que l’auteure nous explique, la problématique abordée ne leur est en rien spécifique. Il s’agit d’un regard lucide sur les méthodes douteuses de marketing des firmes pharmaceutiques, illustrées ici par la dépression, mais qui sont tendanciellement les mêmes quels que soient les maladies et les médicaments. Sauf que le flou dans la définition des troubles mentaux, le fait que les psychiatres sont les spécialistes les plus payés par l’industrie et qu’ils disposent d’un outil mondialement accepté de définition des maladies (le DSM) font que les troubles psychiques sont la cible idéale des marchands : le domaine où la globalisation d’un traitement médicamenteux uniformisé est la plus facile à mettre en pratique.
La marchandisation de la dépression : la prescription des ISRS aux femmes. Par Janet Currie (Action pour la protection de la santé des femmes, mai 2005).
ISRS veut dire "inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine". La sérotonine est un neuromédiateur impliqué dans beaucoup de processus vitaux. L’industrie pharmaceutique a essayé de faire croire qu’un taux bas de sérotonine serait responsable de la dépression et qu’il suffirait de compenser chimiquement cette carence supposée, au moyen des antidépresseurs. Les antidépresseurs homologués depuis une vingtaine d’années sont presque tous des ISRS: Prozac, Zoloft, Seropram, Deroxat/Seroxat…
Quelques extraits du texte pour ceux qui n’ont pas la patience de le lire en entier:
" [Comment expliquer l’énorme augmentation des diagnostics de dépression ?]
(…) Au cours des 15 dernières années, la prévalence de la dépression semble avoir grimpé en flèche. Selon The Economist, 330 millions de personnes dans le monde souffriraient de dépression, chiffre qu’on dit supérieur au nombre de personnes atteintes de maladies cardiaques ou du sida. L’Organisation mondiale de la santé prévoit que, d’ici 2020, la dépression se classera au deuxième rang des maladies les plus débilitantes11. Cette augmentation spectaculaire soulève d’importantes questions. Assiste-t-on bel et bien à une augmentation des cas de dépression exigeant un médicament utilisé en psychiatrie, ou d’autres facteurs sont-ils en jeu?
Avant l’arrivée des ISRS sur le marché, on considérait que la dépression touchait seulement 100 personnes par million. Depuis le lancement de ces médicaments, on estime qu’entre 50 000 et 100 000 personnes par million (soit un taux de 500 à 1 000 fois supérieur) souffrent de ce trouble12. Au Canada, la dépression est le diagnostic qui connaît l’augmentation la plus rapide. Les consultations pour un motif de dépression ont presque doublé depuis 1994 (…). En 2004, 81 % des visites au cabinet du médecin pour un motif de dépression ont abouti à une recommandation d’antidépresseur (…) Avant l’avènement des ISRS, on considérait que, dans la vaste majorité des cas, la dépression était un phénomène résolutif, qui se résorbait de lui-même sans traitement. Or, de nos jours, (…) l’intervention médicamenteuse est jugée impérative au point qu’omettre de prescrire serait considéré comme négligent, voire indéfendable sur le plan juridique14. (…)
Les sociétés pharmaceutiques ont répandu l’idée que la dépression serait en fait un « trouble » d’origine biochimique provoqué par une carence en sérotonine dans le cerveau. Elles ont commercialisé les ISRS comme un moyen de corriger cette « insuffisance » d’une substance chimique déjà présente dans l’organisme. On a tellement insisté sur cette façon de concevoir la dépression, établissant même des parallèles avec le diabète, que l’on comprend pourquoi les gens ont une attitude aussi peu critique face à la prescription des ISRS, même à des enfants.
Il n’y a aucune preuve scientifique que les personnes dépressives souffrent d’une « carence en sérotonine », ou de toute autre dysfonction liée à cette substance, et qu’elles ont besoin de médicaments ayant une action sur celle-ci pour fonctionner normalement. (…)
Les ISRS sont-ils efficaces? [Les résultats négatifs des essais cliniques ne sont pas publiés]
L’utilité de tout médicament d’ordonnance doit être établie en fonction de ses avantages éventuels, de ses risques potentiels et de ses effets nocifs. Selon David Healy, psychopharmacologue, chercheur et auteur, les bienfaits des traitements aux ISRS sont modestes; quant à leurs effets nocifs et aux conséquences de ces effets, ils n’ont jamais été définis18. Les résultats des essais cliniques publiés et inédits permettent de croire que les ISRS n’auraient qu’une portée clinique limitée. (…)
Les efforts visant à évaluer l’efficacité des ISRS sont contrecarrés par la réticence des pharmaceutiques à publier des résultats cliniques négatifs. Le fabricant du Paxil [Deroxat, Seroxat] a même délibérément omis de publier des données révélant que le médicament ne valait guère mieux qu’un placébo chez les enfants; s’il l’avait fait, il aurait couru le risque de perdre le lucratif marché des adultes. Des données inédites concernant le Zoloft, l’Effexor et le Celexa indiquent que, chez les enfants, les risques associés aux ISRS excèdent leurs bienfaits21.
Les pharmaceutiques ne sont pas tenues de publier les résultats cliniques négatifs, et ce, même si ces derniers dominent. Cela signifie que ni les médecins, ni les profanes n’ont accès à une information complète sur les risques et les bienfaits. Par ailleurs, la plupart des essais cliniques sont conçus et financés par les pharmaceutiques et leurs conclusions font, en général, la part trop belle aux avantages. Prenons, à titre d’illustration, les essais contrôlés sur l’usage des ISRS chez les enfants : on obtient des résultats positifs dans la grande majorité (90 %) des essais financés par l’industrie pharmaceutique, mais seulement dans 55,6 % des essais financés par d’autres sources22.
Il est possible de manipuler les résultats cliniques pour les montrer sous un jour favorable. On peut, par exemple, écarter les sujets qui réagissent très positivement au placebo et omettre de décrire leur expérience. Également, il peut arriver que les données concernant les effets nocifs d’un médicament soient mal consignées, puisque leur collecte repose sur les déclarations spontanées des sujets, plutôt que sur l’usage de listes de vérification bien structurées et complètes. Les sujets d’une étude ne connaissent pas nécessairement tous les effets nocifs associés au médicament qu’ils prennent et risquent parfois de ne pas signaler certaines de leurs réactions.
Souvent, les essais cliniques sur les médicaments n’étudient pas en détail les effets nocifs. Dans certains essais concernant les ISRS notamment, la présence d’idées suicidaires n’a été évaluée qu’à partir d’une seule question. Ailleurs, on a rapporté les effets indésirables mais en les édulcorant. Dans un cas, on a choisi le terme « nervosité » pour décrire l’état d’agitation grave qui s’était manifesté chez certains sujets.
Les effets nocifs attribuables aux ISRS [effets indésirables]
La documentation actuelle confirme que les réactions indésirables aux ISRS sont courantes, diversifiées et graves. Dans le cas du Prozac, l’information fournie par le fabricant indique que ce produit est associé à 242 effets secondaires différents, dont 34 affectent les voies génitales et urinaires. Une analyse des réactions indésirables rapportées spontanément à la FDA a montré qu’« aux États-Unis, sur une période de dix ans, le Prozac a été associé à un plus grand nombre d’hospitalisations, de décès et d’effets nocifs graves que tout autre médicament23 ». Spigset a conclu que les problèmes les plus courants associés aux ISRS étaient d’ordre neurologique (22 %), psychiatrique (19,5 %), gastro-intestinal (18 %) et dermatologique (11,4 %). En ce qui concerne les effets nocifs les plus graves, on constate que le taux d’incidence est plus élevé chez les femmes que chez les hommes24. Selon Vanderkooy, entre 10 % et 32 % des personnes qui ont pris de l’Eflexor, du Paxil ou du Zoloft ont éprouvé de la nervosité, de l’agitation, des tremblements, des étourdissements, de la myoclonie, des maux de tête ou des troubles du sommeil25.
Les ISRS peuvent engendrer des effets sur la fonction motrice et des complications à long terme semblables à ceux des anti-psychotiques (indiqués dans les cas de schizophrénie ou de psychose), dont des symptômes extrapyramidaux ou des mouvements anormaux comme le syndrome de Parkinson, l’acathisie (agitation intérieure), la dystonie (spasmes musculaires) et la dyskinésie chronique (mouvements anormaux ou spasmes musculaires). Ces réactions peuvent toucher tous les patients à des degrés divers, se manifester des semaines ou des mois après la prise du premier comprimé et se poursuivre après l’interruption du traitement26. Les ISRS sont également associés au syndrome de la sérotonine. Il s’agit d’une réaction grave liée à la dose, pouvant causer une excitabilité neuromusculaire, de l’hyperthermie, une altération du tonus musculaire, des fluctuations de l’état mental et une instabilité du système nerveux autonome. S’il n’est pas traité, ce syndrome peut engendrer d’autres réactions : coma, convulsions, forte fièvre, acidose métabolique, rhabdomyolyse, insuffisance rénale et même la mort27.
Chez certains usagers, l’apparition d’une « dépression agitante » est l’un des facteurs justifiant l’association des ISRS au risque accru de suicide28. Même si les sociétés pharmaceutiques l’ont longtemps nié, il est désormais reconnu que le risque relatif de suicide et de tentative de suicide est deux fois plus élevé chez les usagers d’ISRS que chez les personnes qui prennent des antidépresseurs de la génération précédente ou qui ne prennent rien du tout. Ce risque peut être trois fois supérieur ou davantage chez les personnes à faible risque recevant des soins primaires pour la dépression29. En mars 2004, la FDA a publié un avertissement rappelant la nécessité de surveiller étroitement les patients qui prenaient des ISRS afin de déceler toute aggravation de leur état dépressif et des tendances suicidaires. Le document signalait également d’autres effets indésirables associés aux ISRS : anxiété, agitation, crises de panique, insomnie, irritabilité, hypomanie et manie30.
Les dysfonctions sexuelles (perte de libido, dysfonction orgasmique et, chez l’homme, éjaculation tardive) sont parmi les effets secondaires courants associés aux ISRS. Ici encore, on compte peu d’essais sur échantillon aléatoire et contrôlé ayant tenté d’établir précisément leur fréquence. À l’origine, les sociétés pharmaceutiques estimaient le taux de prévalence à 5 %, mais des études subséquentes ont indiqué qu’il se situerait plutôt entre 30 et 70 %31. On craint en outre que certaines dysfonctions ne disparaissent pas entièrement une fois le traitement achevé. (…) Une dysfonction sexuelle peut avoir des conséquences néfastes sur les relations intimes, à plus forte raison si elle se conjugue aux autres effets que les ISRS peuvent engendrer (aggravation de la dépression, effets paradoxaux, émoussement des émotions ou détachement, pertes de mémoire et confusion).
Les ISRS entraînent de nombreux effets sur l’appareil gastro-intestinal : douleurs gastriques, sécheresse de la bouche, nausées, constipation, perte ou accumulation de poids, dyspepsie et vomissements32. Ils peuvent aussi accroître le risque de saignement de l’appareil gastroduodénal, un effet potentialisé par l’usage concomitant d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
On sait que les médicaments psychotropes comme les benzodiazépines (calmants) et les hypnotiques (somnifères) contribuent de manière significative à la prévalence des chutes et des fractures chez les personnes âgées34. (…)
Les ISRS agissent aussi sur l’appareil cardiovasculaire et peuvent produire des spasmes vasculaires en présence de coronaropathie, une maladie courante36.
Même si les recherches sont toujours en cours, il existe des preuves scientifiques que les ISRS peuvent être néfastes pour la femme enceinte ou l’enfant qu’elle porte. Selon une étude menée par Chambers, l’incidence de plus de trois anomalies d’origine génétique était de 15,5 % chez les nourrissons qui avaient été exposés au Prozac pendant la gestation. Le 9 août 2004, Santé Canada a émis un avis à l’intention des femmes enceintes qui prenaient des ISRS pendant le troisième trimestre. Selon ce document, ces bébés risquent d’éprouver des problèmes de sevrage. En effet, dans certains cas, des complications survenues à la naissance ont nécessité une hospitalisation prolongée, une assistance respiratoire et une alimentation par sonde. Parmi les symptômes rapportés, on mentionne une difficulté à s’alimenter et à respirer, des convulsions, une rigidité musculaire, un état d’agitation et des pleurs incessants. Ces symptômes pourraient être attribuables aux « effets associés à l’interruption » (conséquences du sevrage) ou à d’autres effets des ISRS38. On a trouvé des ISRS dans le lait maternel. On ignore toujours si l’exposition à ces médicaments influe sur le développement neurocomportemental de l’enfant39.
L’usage des ISRS peut aussi contribuer à la multiplication des séjours à l’hôpital et aux coûts qu’ils entraînent. Sheffield et al. ont montré qu’il existait un lien significatif entre l’éventualité d’une hospitalisation et le fait de changer d’ISRS ou d’en augmenter la dose40.
Les ISRS sont-ils toxicomanogènes? [Y a-t-il des risques de dépendance ?]
Dès la mise à l’essai du Prozac, on savait que les ISRS pouvait engendrer une toxicomanie ou une dépendance et que l’interruption du traitement pourrait être difficile ou provoquer des symptômes de sevrage. (…)
Les sociétés pharmaceutiques ont d’abord vigoureusement nié l’existence de tout symptôme de sevrage41. Jusqu’à 2001, les fabricants du Paxil prétendaient que les effets liés au sevrage ne dépassaient pas 0,0001 %. De 1992 à 1997, tout au long d’une campagne nationale de lutte contre la dépression menée en Grande-Bretagne et financée par le fabricant et le gouvernement (Defeat Depression [Vaincre la dépression]), on a constamment réitéré le message suivant : les antidépresseurs ne sont pas toxicomanogènes. On a conseillé aux médecins de dire à leurs patients que les problèmes de sevrage liés aux ISRS étaient rares et peu graves.
Dans le cadre d’une stratégie destinée à nier ou à minimiser le phénomène de dépendance associé aux ISRS, les sociétés pharmaceutiques ont mené une campagne concertée visant à redéfinir la notion de pharmacodépendance dans le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux). Selon la nouvelle définition, la dépendance physique découlant de la tolérance aux médicaments ne serait pas suffisante en soi pour conclure à une « dépendance ». Il faudrait également qu’un patient manifeste un comportement « abusif » ou toxicomaniaque.
Étant donné que la majorité des patients qui prennent des ISRS observent fidèlement les doses qui leur sont prescrites, on ne peut parler de surconsommation; par conséquent, au sens même de cette définition, il est impossible qu’un patient soit dépendant, et ce, même s’il lui est difficile ou impossible d’interrompre le traitement en raison des symptômes de sevrage qu’il éprouve. Selon Charles Medawar, « on décrétait unilatéralement que la “dépendance” était assimilée à la toxicomanie. Encore une fois, on considérait que les usagers étaient les seuls responsables de leurs problèmes de dépendance43 ». Les médecins et les pharmaceutiques ont diffusé cette nouvelle définition puisqu’elle exonérait le médicament et le médecin prescripteur de toute responsabilité en cas de dépendance. En fait, c’est le fabricant du Prozac, Eli Lilly, qui a signalé les effets de sevrage de ces médicaments. Son intervention visait le Paxil, un produit concurrent. Eli Illy a toutefois soigneusement évité l’expression « symptômes de sevrage », préférant l’expression « symptômes ou effets liés à l’interruption du traitement », plus inoffensive. Le fabricant a d’ailleurs conseillé à ses employés d’éviter le mot « sevrage » puisqu’il implique une accoutumance44.
Depuis, les recherches ont démontré qu’entre 35 % et 85 % des personnes qui cessent brusquement de prendre un ISRS éprouveront des symptômes de sevrage. Dans le cas d’un médicament à action brève comme le Paxil ou l’Effexor, ces symptômes peuvent apparaître quelques heures après l’interruption ou la diminution de la dose. En voici une liste non exhaustive : brusques sautes d’humeur, aggravation de la dépression, variations de l’appétit, insomnie, sensations de choc électrique et agitation. Étant donné que ces symptômes imitent le problème qui avait motivé la prescription du médicament (la dépression, par exemple), le patient et son médecin croiront qu’il s’agit d’une rechute. On prescrira parfois d’autres substances ou une plus forte dose pour neutraliser des symptômes qui auraient été causés par le médicament même.Les études par observation n’ont pas permis d’établir la durée des effets associés au sevrage.
Les ISRS et d’autres médicaments apparentés sont abondamment prescrits par les médecins; ceux-ci sont pourtant peu nombreux à connaître leurs effets indésirables. Dans une enquête sur l’état des connaissances, Young et Currie ont découvert que 70 % des médecins ignoraient que les antidépresseurs pouvaient provoquer des épisodes de sevrage. Seulement 17 % d’entre eux ont précisé qu’ils mettraient leurs patients en garde contre cette éventualité46.
Pourquoi prescrit-on plus d’ISRS aux femmes qu’aux hommes?
(…) Certains facteurs physiologiques amèneront plus souvent les femmes à se tourner vers les services médicaux, d’où peut-être le nombre élevé de diagnostics de dépression ou d’anxiété qu’elles reçoivent, affections pour lesquelles la prescription de médicaments psychotropes comme les ISRS est devenue monnaie courante. Cooperstock a démontré que les femmes sont davantage portées que les hommes à signaler les effets psychologiques ou sociaux de leurs problèmes de santé, ce qui pourrait expliquer qu’on diagnostique chez elles plus de cas de psychonévrose, d’anxiété ou d’autres états instables48. Simoni-Wastila et al. ont découvert qu’une femme qui consulte son médecin a plus de chance de se faire prescrire un psychotrope que n’en a un homme, et ce, même après avoir tenu compte de paramètres comme le diagnostic, les variables démographiques, la couverture médicale et la spécialité du médecin49.
Plusieurs autres facteurs peuvent expliquer pourquoi on prescrit plus de médicaments psychotropes aux femmes qu’aux hommes50.
Les phénomènes de nature physiologique qui amènent les femmes à fréquenter les servicesde santé sont nombreux : menstruation, grossesse, allaitement, ménopause. La plupart de ces phénomènes naturels ont été médicalisés par les sociétés pharmaceutiques, qui leur ont accolé l’étiquette de trouble nécessitant un traitement médicamenteux (p. ex. la ménopause conçue comme un état carencé).
Les maladies chroniques comme l’arthrite touchent davantage les femmes et les incitent à consulter un médecin plus souvent que les hommes.
Les femmes sont davantage portées à consulter un médecin si elles souffrent de symptômes non somatiques comme la dépression ou l’anxiété.
Les rôles multiples et variables que doivent assumer les femmes sont parfois pour elles une source de grand stress, tout comme le manque de temps pour se reposer et se divertir,l’absence de soutien familial et la monoparentalité, qui peuvent s’exprimer par des symptômes physiques ou psychologiques.
La pauvreté et les conditions matérielles déplorables dans lesquelles vivent de nombreuses femmes (logement insalubre, prestations de retraite modestes, par ex.) peuvent être à l’origine de la dépression ou de problèmes de santé.
Les femmes occupent souvent des emplois stressants (infirmières, enseignantes, travailleuses sociales, par ex.). Selon Morrisette, 15 % des professionnelles prennent des médicaments psychotropes pour affronter la pression et les problèmes qu’elles subissent au travail et surmonter le stress, l’anxiété et la fatigue51.
Les femmes sont souvent victimes de violence familiale, y compris les mauvais traitements sexuels à un jeune âge. Ces incidents peuvent engendrer ultérieurement de l’anxiété ou la dépression.
Les hommes cherchent parfois d’autres moyens d’exprimer leur détresse (la consommation d’alcool, par ex.) au lieu de consulter un médecin.
D’autres facteurs peuvent aussi servir à expliquer pourquoi l’on prescrit plus d’antidépresseurs ISRS aux femmes qu’aux hommes. Depuis plus de cinquante ans, les sociétés pharmaceutiques affirment que la détresse psychologique que peut susciter chez les femmes un événement traumatisant ou de la vie courante relève d’un « déséquilibre biologique » qu’il faut traiter à l’aide de puissants médicaments.
Le développement de la psychiatrie biologique
(…) Dans les principales revues d’actualités et la presse féminine des années 1950 et 1960, on recense plusieurs articles selon lesquels, grâce à la psychopharmacologie, « il est désormais possible pour une femme de soulager un trouble émotif en avalant un simple comprimé que lui aura prescrit son médecin ». Parmi les troubles évoqués, on trouve notamment « la frigidité chez l’épouse, l’incertitude éprouvée par la future ou jeune mariée et l’infertilité chez la femme54 ».
Certains ouvrages, dont Recognizing the Depressed Patient (1961), préconisaient le dépistage de la dépression dans la population par les généralistes, plutôt que par les seuls psychiatres dans les hôpitaux. Les sociétés pharmaceutiques ont largement diffusé ces ouvrages, y voyant une occasion de grossir les rangs des prescripteurs éventuels. La société Merck avait d’ailleurs acheté 50 000 exemplaires de ce volume, qu’elle avait distribués partout dans le monde55. (…)
« Vendre » la théorie de la dépression [vendre la maladie: meilleur moyen pour vendre les psychotropes]
Pour vendre un produit, les pharmaceutiques doivent convaincre le consommateur qu’il en a besoin. Avant l’introduction des ISRS, on croyait généralement que le « marché de la dépression » était restreint. La « dépression » demeurait une notion assez floue; quant à la dépression grave, on considérait que son taux de prévalence était faible et qu’elle touchait essentiellement des patients hospitalisés pour une longue durée. Les spécialistes estimaient que la dépression était l’un des troubles psychiatriques offrant le meilleur pronostic, avec ou sans traitement. (…)
Dans les années 1980, la mondialisation des marchés et le déréglementation du secteur ont incité l’industrie pharmaceutique à revoir sa position sur les antidépresseurs. Les fabricants ont alors commencé à décrire la dépression comme un « état carencé ». Le message transmis aux médecins et aux consommateurs était le suivant : les personnes déprimées devaient prendre des ISRS pour relever « le taux affaibli de sérotonine » dans l’organisme, à l’image des diabétiques qui prennent de l’insuline. (…) Les pharmaceutiques ont continué d’alimenter la théorie de la carence en sérotonine longtemps après que les scientifiques l’eurent rejetée. Outre son efficacité sur le plan promotionnel, cet argument comporte d’autres avantages. Comme le souligne Charles Medawar, « La théorie de la carence en sérotonine aura permis de banaliser la dépression, en la débarrassant de son étiquette de maladie mentale, […] d’affranchir les patients de la honte et de la culpabilité et […] d’étouffer les soupçons concernant les éventuelles propriétés toxicomanogènes du médicament »61.

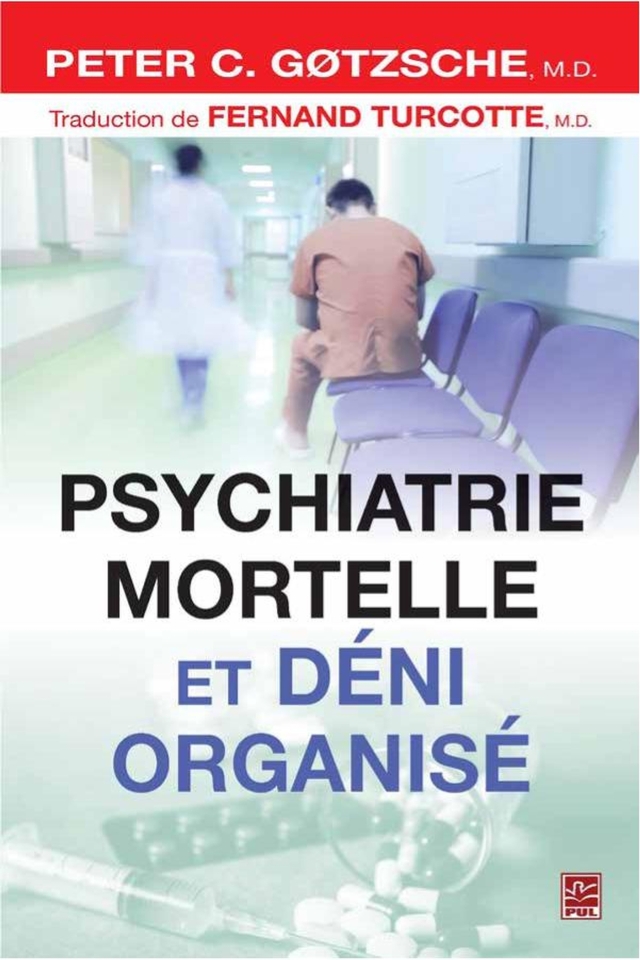





 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa







